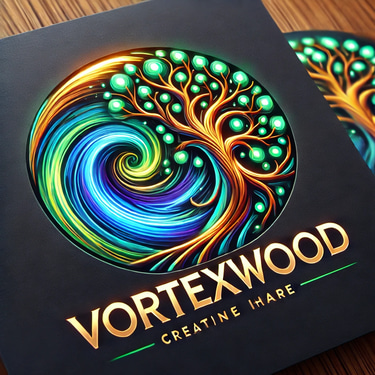L’avenir de la jeunesse africaine dans la politique : entre espoir et désillusion
SOCIETE ET PSYCHOLOGIE
10/27/20253 min read

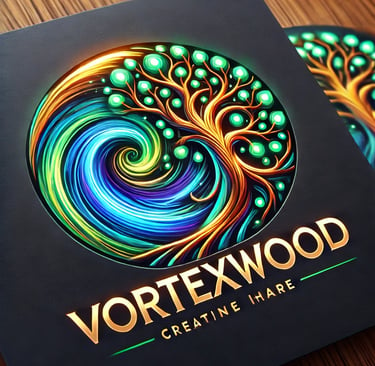
Introduction
L’Afrique est le continent le plus jeune du monde : plus de 60 % de sa population a moins de 25 ans. Ce dynamisme démographique constitue à la fois un atout et un défi. Dans un contexte où de nombreux pays sont encore confrontés à des crises politiques, économiques et sociales, la jeunesse africaine se retrouve au cœur des débats sur l’avenir de la gouvernance. Mais entre espoirs de changement et désillusions face à des systèmes verrouillés, quelle place la jeunesse occupe-t-elle réellement dans la politique africaine ?
1. Une jeunesse nombreuse, mais marginalisée
La force démographique de l’Afrique est indéniable. Dans des pays comme le Niger, le Mali ou l’Ouganda, la moitié de la population a moins de 18 ans. Pourtant, cette masse critique est souvent écartée des processus de décision.
• Les parlements restent dominés par des élites âgées, parfois au pouvoir depuis plusieurs décennies.
• L’âge minimum pour se présenter à certaines élections reste élevé, ce qui limite la participation.
• Les jeunes manquent souvent de ressources financières pour financer des campagnes électorales.
Résultat : bien que majoritaires, les jeunes sont sous-représentés dans les instances dirigeantes.
2. Les aspirations d’une nouvelle génération
Malgré ces obstacles, la jeunesse africaine exprime de plus en plus son désir de changement.
• Révolutions citoyennes : des mouvements comme le Balai Citoyen au Burkina Faso ou Y’en a marre au Sénégal ont montré la capacité des jeunes à mobiliser les foules contre des régimes jugés injustes.
• Engagement numérique : les réseaux sociaux deviennent des espaces de contestation et de sensibilisation. Twitter, Facebook et TikTok servent à dénoncer la corruption et à exiger plus de transparence.
• Innovation sociale : certains jeunes choisissent d’agir en dehors de la sphère politique classique, en créant des ONG, des start-ups sociales ou des initiatives locales.
Ces nouvelles formes d’engagement montrent une volonté d’inventer une politique différente, plus proche des réalités quotidiennes.
3. Les obstacles persistants
Si la jeunesse africaine aspire à jouer un rôle politique plus important, plusieurs freins ralentissent sa progression.
• Le chômage massif : selon l’OIT, près de 12 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail africain, mais seuls 3 millions trouvent un emploi formel. Le reste survit dans l’économie informelle.
• La corruption : la politique est souvent perçue comme un milieu fermé où les postes se négocient entre élites.
• La répression : dans certains pays, les jeunes qui manifestent pacifiquement sont arrêtés, intimidés ou censurés.
• La fracture éducative : beaucoup de jeunes n’ont pas accès à une formation politique ou citoyenne, limitant leur capacité à peser dans les débats.
Ces obstacles nourrissent une désillusion croissante, poussant certains jeunes à se détourner complètement de la politique.
4. Les signes d’espoir et de renouveau
Malgré ces difficultés, des avancées sont visibles.
• Jeunes élus : dans plusieurs pays, des députés ou maires de moins de 35 ans émergent, symbolisant un renouvellement timide.
• Constitutions révisées : certains États abaissent l’âge minimum pour se présenter aux élections, comme le Nigeria avec la campagne Not Too Young To Run.
• Diaspora active : les jeunes africains de l’étranger s’impliquent aussi, via le lobbying, les transferts de compétences et les financements de campagnes locales.
• Leadership féminin : de plus en plus de jeunes femmes s’imposent dans l’espace politique, brisant les barrières culturelles et sociales.
Ces initiatives, même limitées, ouvrent la voie à une transformation progressive de la scène politique africaine.
5. Quel avenir pour la jeunesse africaine en politique ?
Le futur dépendra de plusieurs facteurs :
• La volonté des gouvernements à inclure les jeunes dans les institutions, non pas comme figurants, mais comme acteurs clés.
• Le renforcement de l’éducation civique pour former une génération consciente de ses droits et devoirs.
• L’accès aux nouvelles technologies qui offrent à la jeunesse un espace d’expression et de mobilisation inédit.
• La pression de la société civile et de la communauté internationale, qui peuvent encourager la démocratisation et l’ouverture.
Si ces conditions sont réunies, la jeunesse africaine pourrait devenir la force motrice d’une nouvelle gouvernance, fondée sur la transparence, l’innovation et la justice sociale.
Conclusion
La jeunesse africaine est à un carrefour historique. Majoritaire en nombre, elle reste minoritaire dans les décisions politiques. Entre frustrations, désillusions et élans d’espoir, elle cherche à redéfinir son rôle dans la gouvernance du continent.
L’avenir dépendra de sa capacité à transformer son poids démographique en influence politique réelle. Une chose est certaine : l’Afrique de demain ne pourra pas se construire sans sa jeunesse.
©2025 Vortexwood est un site de divertissement accessible gratuitement. Nous nous limitons a référencer des liens vidéos provenant de plateformes publique reconnues et respectant les cadres légaux ( telles que YouTube, Dailymotion etc.). Aucun contenu n'est directement hébergé sur nos serveurs. Pour toutes réclamations ou problème lié aux vidéos, nous vous invitons a vous adresser directement aux plateformes concernées.
© 2024. All rights reserved.